Resistant SNCF

_____________
Jean Courcier
fait parti de nos camarades Resistant
_________
"Ceux qui en sortiront, il faudra qu'ils racontent".
_____
Né le 4 février 1921 à Bonnemain en Ille-et-Vilaine dans une famille modeste. Il n'a pas connu son père. Il obtient son brevet industriel et son CAP d'ajusteur tourneur à l'École pratique d'Industrie de Dol-de-Bretagne.
Il est embauché dans les ateliers de construction de la SNCF en septembre 1937 à 16 ans. Il adhère à 17 ans aux Jeunesses communistes.
|
Groupe de jeunes des ateliers de la SNCF en 1938. Jean Courcier est le troisième debout à partir de la gauche. Le cinquième est René Piguel, le huitième Raymond Le Cornec et le dixième Roger Dinard |
Ses premiers actes de résistance et son arrestation
Avec Henri Bannetel et Le Herpeux, des étudiants en médecine, il imprime le premier tract anti allemand, en décembre 1940 qui sera distribué chez les étudiants et les ouvriers de la SNCF. Lors de la visite de Borotra, ancien joueur de tennis et ministre du maréchal Pétain, il peint sur les murs des ateliers, rue Pierre Martin"A bas Laval" et une croix de Lorraine. Il participe à la destruction des étiquettes de wagon de marchandises en partance pour l'Allemagne.

Au mois d'août 1941, il est arrêté avec 8 autres jeunes travaillant tous à la SNCF par la police française(La SPAC, service de police anticommuniste). Après avoir été interrogé à la Préfecture, il est conduit menottes aux mains à la prison Kergus
Le 13 septembre 8 jeunes communistes sont traduits devant la Cour d'Appel, section spéciale "pour détention et de distribution de tracts communistes, tendant à la reconstitution du parti dissous, par adhésion et versement de cotisation." Les peines sont lourdes: de 4 ans à 1 an de prison. Un seul est acquitté. 6 seront déportés par la suite en Allemagne. René Piguel décédera en déportation.
Les prisons françaises
Transférés quelques jours plus tard dans une prison du Mans puis trois semaines après, à la centrale de Poissy:
"C'était terrible comme centrale , incroyable: interdiction de parler,, interdiction de fumer... On nous habille , des gros sabots sans chaussettes, un béret, chemise à rayures rouges, des chaussons faits maison et un chiffon autour du cou, appelé cravate, un caleçon et une musette sur le dos, le bagnard quoi."
Georges Neveu, 40 ans, un camarade de Fougères qui ne faisait pas partie de notre groupe dit un jour au réfectoire:"Oh! c'est dégueulasse cette pitance" et il la donne à son voisin.
Et hop! quatre jours de pain sec: ce geste est considéré comme un trafic.
René Prey a eu 60 jours de mitard, parce qu'il était allé aux WC sans demander. Ce n'est pas le gardien qui l'a puni, c'est le sous-directeur qui a décidé de la peine. C'était extrêmement dur. Il était en en quartier disciplinaire, la prison dans la prison, gardé pour un prévôt de quartier, qui avait tous les droits sur les détenus. Ils les tabassaient en arrivant, leur donnant la gamelle qui voulait. Heureusement, Prey a été soutenu par les douaniers, mais il en est sorti vraiment très maigre.
Le 20 septembre, le jour de Valmy, nous quittons Poissy pour la prison de Melun, en chantant l'Internationale. et la Marseillaise."
Il tente de s'évader avec des camarades le 22 novembre, mais l'alerte est donnée. Il rentre dans sa cellule. Il est ensuite transféré à Chalons-sur-Marne. Sa peine se termine. Le 3 avril, ses vêtements civils lui sont remis. Il descend de sa cellule pour être remis à deux feldwedels (gendarmes). Il est emmené à Fontainebleau puis est dirigé sur le camp de Romainville.
|
Dernière lettre écrite avant son départ en Allemagne
|
|
|
Le 6 avril 1944, il part pour l'Allemagne avec 1500 prisonniers
|
Jean Courcier glisse un billet à travers deux lattes du wagon au départ de Compiègne pour l'Allemagne. Ce billet est retrouvé par un cheminot qui l'expédie à sa mère, Mme Suzanne Guillas. |
La déportation Gusen I
"Mis en quarantaine depuis notre arrivée au camp central de Mauthausen (convoi du 6 avril 1944) c'est le 8 mai qu'un groupe de détenus est désigné pour Gusen 2.
Étant du nombre, Manuel le "Block friseur" espagnol qui sympathise avec les Français me dit : « C'est très mauvais. » IL me donne un morceau de papier où il a écrit "Buenos camarade" (qui me vaudra une bonne raclée par la suite).
Le chef de bloc s'appelle Fernand, un Espagnol lui aussi. Un autre convoi part pour Melk, eux auront plus de chance.
Nous partons dans un camion qui nous transporte d'abord à Gusen 1 où nous passons deux nuits dans les combles d'un vieux bâtiment en pierre avant d'être dirigés vers Gusen 2, tout à côté. Apparemment le camp est en construction et les premiers jours nous installons des châlits et y mettons de la paille. Entre les baraquements c'est un bourbier, à part l'allée de sortie du camp qui mène à un simple portail grillagé gradé par des "posten". Nous faisons connaissance avec les "kapos", genre débiles mentaux qui matraquent pour un rien. Ce sont surtout des Polonais et des Allemands.
Ils nous emmènent à côté d'un grand concasseur à Gusen 1 pour y chercher des pierres que nous déversons entre les baraques, et nous font faire des corvées pour aménager le camp.
Un matin, ce fut à mon tour d'être intégré, après l'appel, dans un commando qui avec tous les autres prend la navette pour "San Gorgen" où se trouve la fameuse usine souterraine. Fini le bricolage au camp. En passant le portail, le kapo polonais annonce : « Commando Bora 41 Haflingen », et nous allons vers le train qui nous attend (des wagons découverts). Notre équipe est chargée de pelleter les gravats des marteaux piqueurs. Nous les jetons sur un tapis roulant qui remplit les wagonnets que nous poussons ensuite vers l'extérieur. Nous respirons mal avec le bruit, la poussière, les fuites d'air comprimé et la puanteur, c'est l'enfer ! Le Polonais nous surveille en fumant. J'ai la frousse que la montagne ne s'écroule sur nous, malgré le boisage des galeries effectué par des spécialistes autrichiens.
Le soir la navette nous ramène au camp complètement épuisés. Seule satisfaction nous avons un pain pour trois alors que d’autres le partagent en quatre. Mais je n’y reste, par chance, que trois jours.
Un matin, après l’interminable appel et la grande bousculade pour la formation des commandos, un Kapo me met d'autorité dans son groupe malgré mes protestions, je cherchais le mien. Il lui manquait un homme juste au moment de franchir le portail de sortie du camp. Tête droite et découverte, bras collés aux cuisses pour être comptés j'entends le kapo crier : « Kommando Kippen 31 hafling », nous sortons vers la navette. Ouf ! J'avais tellement peur d'être reconnu par le kapo d'hier ! A trois cents mètres de là, c'est l’embarquement dans les wagons découverts. A coups de crosses nous devons nous y accroupir serrés, pour le court trajet qui nous sépare de l'usine. Ce sont de jeunes Ukrainiens enrôlés dans l'armée allemande qui nous tassent.
Comme tous les matins, arrivée à Saint-Georges, la navette déverse ses hommes rayés et c'est encore la cohue pour retrouver son commando. Certains paniquent, l'ordre de la matraque sévit. Nous nous alignons derrière le kapo que je n'avais pas perdu de vue durant le trajet. En tournant le dos au tunnel, aux habituels commandements, Links, Zwei, Drei, Vier... Links, Zwei, Drei, Vier, nous longeons une voie ferrée étroite sur une immense dune de sable.
Après avoir fait à peine cent mètres, le kapo après un juron contre les "Germanskis" se met à scander : « ras dva, ras dva, ras dva » et « Stanovice po piat » (en rang par cinq, 1-2,1-2,1-2) ; nous étions dans l'armée rouge.
Je m'aperçois être le seul Français du groupe ; tous ont les lettres R ou SU sur leurs matricules comme le kapo lui-même, et cela m'inquiète beaucoup. Mais le soleil qui commence à briller me rassure, je ne serai plus sous terre.
Quel changement avec les souterrains d'hier ! Et nous marchons seuls sans gardien apparent. Au bout de la voie ferrée un "meister" civil et un "posten", fusil sous le bras, nous attendent. Chacun en habitué prend une pelle, une pioche ou une perche en bois. A mon grand étonnement certains s'assoient sur le sable, d'autres se réchauffent en battant les bras où se frottant mutuellement le dos, car les matins sont froids là-bas, il faut attendre 10 heures pour se réchauffer au soleil. Ils parlent beaucoup, c'est pénible de ne rien comprendre.
Les regards sont tournés vers le tunnel. J'inspecte les lieux, nous sommes sur une longue dune de sable qui domine des champs cultivés, une famille à deux cents mètres de nous travaille dans un champ que le sable envahit de plus en plus. Au loin, l'orée du bois et des bâtiments, sans doute leur ferme.
|
C'est au cri de "Paravoz idiot" que tout le monde est debout (la locomotive arrive), je n'aperçois qu'une fumée au loin. Ils sont vigilants et ont intérêt à l'être car parfois sur la locomotive arrive en même temps un SS qui vient inspecter le commando. Aussitôt le convoi arrêté, avec les perches, les wagonnets sont décrochés, basculés et vidés dans le remblai. Après le départ du convoi le sable est aplani, pour pouvoir riper la voie deux ou trois fois par jour, au bord de la dune avec nos leviers. Le kapo Michka n'est "opérationnel" que quand le SS est présent ou quand le "meister" se fâche et se met à hurler face à l'inertie dans le travail de ses trente "ouvriers". En effet, c'était celui qui en ferait le moins, je m'en suis tout de suite aperçu et vite j'ai compris leur "Pomalo roboté" (travail doucement). Mais il fallait bien que les wagons se vident, alors Michka faisait son cinéma en nous secouant avec son "Goumi". Il allait même parfois jusqu'à s'excuser ensuite de ses brutalités (du jamais vu !...). Le train vidé, nous nous retrouvons assis et toujours guettant l'apparition d'une nouvelle fumée. |
|
|
Dessin de Bernard Aldebert |
Parfois, pour notre plus grand bonheur elle se faisait attendre, c'est là que le meister autrichien criait : « Rouski ein lied ». Alors un chant à plusieurs voix se faisait entendre sur la dune dirigé par le kapo, certains sifflaient ou frappaient dans leurs mains. "Le posten" écoutait ainsi que la famille paysanne et leurs deux enfants. Quel étonnement d'entendre ces trente gaillards blonds, bruns, jaunes aux yeux bridés venus de régions si différentes, et dans ce contexte, donner une telle leçon d'humanité. Eux, les rescapés d'une guerre terrible qu'ils subissaient depuis quatre années. Ils me raconteront plus tard que villages incendiés, pillés, les habitants pendus, les prisonniers exterminés par l'armée nazie ; j'écoutais sans trop les croire, hélas ! c'était encore en dessous de la vérité. Moi qui, depuis trois ans étais dans la chiourme, j'avais oublié que la vie c'était aussi ça, le chant, la musique, ils me le rappelaient eux qui pourtant n'étaient pas des tendres et ne "tricotaient pas dans la dentelle" comme on dit. C'était un moment de revanche sur la barbarie qui nous entourait.
Hélas ! souvent une nouvelle fumée interrompait le concert et de nouveaux wagons se présentaient à nos pelles et nos perches pour les vider. Les jours où nous avions eu ces longues poses, quand nous retournions prendre la navette pour rejoindre le camp, on pouvait voir les commandos du tunnel transporter leurs morts, ficelés sur deux perches ; il y avait eu un éboulement dans les "Stol". Le malheur des uns faisait le bonheur des autres. Nous en avons fait la cruelle expérience.
L'hiver, le gel ou la neige faisait dérailler les wagonnets. La machine patinait en remontant la dune, malgré le sable lancé sous ses roues, pour notre plus grande joie. Car nous allons le payer cher notre soleil d'été, les mauvais jours venants, c'est la pluie, c'est la pluie, le gel et la neige qui nous agressent. Nous ne portions pas de grandes capotes rayées comme je l'ai vu dans certains camps.
Le meister et le posten (de vieux soldats de la Whermart, qui, vers le mois de mai, avaient remplacé à l'extérieur du camp les jeunes SS partis sur le front russe) nous laissaient faire un feu avec les déchets de planches trouvés dans les wagonnets. Sans ce feu, le travail aurait été impossible.
A ['arrivée des trains, contrairement aux jours d'été, on se précipitait sur le convoi pour le vider et retourner vite autour du feu. Michka avaient bien du mal à nous en déloger, il se servait de son goumi et jurait tant qu'il pouvait. L'usine n'arrêtait pas et produisait nuit et jour des pièces d'avion. Les souterrains s'agrandissaient et la butte de sable grossissait chaque jour. Le soir, on croisait l'équipe de nuit qui venait nous relayer. Nous échangions quelques mots à propos du pain, de la soupe qui nous attendait dans l'infernal camp "Gusen II". Nous les informions où étaient cachés, dans le sable, de vieux pull-overs dénichés je ne sais où et des sacs de papier ciment (strictement interdits) que l'on mettait contre le froid.
Cette deuxième équipe n'était composée, comme la nôtre, que de Soviétiques. Comment s'étaient-ils débrouillés pour être ensemble ? Au camp, ils étaient aussi mal vus que les juifs polonais et hongrois arrivés en mai. Pourtant, fin août, deux autres Français furent intégrés au commando. Mon copain de paillasse Jacob Toussaint, Breton comme moi, et Christian Brignot, un gars de la Côte-d'Or. C'est ce qui a donné l'idée à notre mélomane de meister de nous faire chanter tous les trois. Car la chorale continuait même la nuit autour du feu. A notre honte, nous n'avons pas été capables d'en "pousser une". Heureusement, Christian, le Dijonnais, avec sa belle voix de basse et ses airs d'opéra, a su sauver notre honneur ! Mais le brave n'a pas résisté aux conditions de vie qui nous étaient faites. Il n'a jamais revu le n° 1 rue de la Côte-d'Or où il habitait avec sa femme et ses deux enfants. Certains jours, il n'y avait pas de train pour nous transporter à l'usine, alors nous faisions le trajet du camp à San Gorgen à pied, ce qui accentuait notre fatigue. On pouvait presque côtoyer les habitants du village, leurs enfants, qui parfois nous jetaient des pierres en riant. Jamais un geste de sympathie de leur part. L'été, les fleurs, les légumes et les arbres de leurs jardins s'offraient à notre regard avec envie. Pour eux, la vie continuait. Que pensaient-ils de nous, avaient-ils peur ?
Ces jours-là, autour du feu, mes Russes sortaient de leurs chemises soit une ou deux patates ou même une betterave et les faisaient cuire. En effet, ils n'hésitaient pas à sauter dans un fossé pour récupérer ces précieuses denrées. La solidarité fonctionnait dans le commando. J'ai le souvenir de Chourabora, un solide gaillard qui avait eu l'idée "d'échanger" ses galoches avec celles d'un "Stubendienst", beaucoup plus belles comme il se doit. Surpris par le chef de bloc, ils l'ont, à eux deux, tellement tabassé que c'est dans les lavabos (les washrums) qu'il a été jeté avec les morts habituels de la nuit. Récupéré par Michka et ses copains, il a pu subir l'appel du matin et passer le portail avec le commando pour prendre la navette. Pendant quelques jours, avec l'accord du posten qui nous comptait sans arrêt, il est resté allongé dans la cabane du master sans travailler, a repris des forces et s'en est bien tiré. Mais il revenait de loin.
Comme les autres, seul étranger dans leur groupe, je profitais de leur solidarité et même de leurs larcins et suis devenu le "Malyï Frantsouz" (le petit Français). Bien accepté aussi, parce que sous mes deux matricules (62208) et dans le dos, j'avais une cible rouge de cousue (la gestapo française avait fait son travail), un des leur portait les mêmes décorations. Plus tard, j'ai su que nous n'étions que deux Français à Gusen I et II à être marqués de la sorte. L'autre copain s'appelait Martel, je ne l'ai jamais vu. Les paysans travaillant près de nous le savaient par le civil autrichien, et, curieusement, le soldat qui nous gardait à leur demande criait : « Franzose come. » Je descendais la dune de sable pour prendre la brioche que me tendait une des deux enfants et l'engloutissait aussitôt. Ils ont renouvelé ce geste plusieurs fois. La solidarité française au camp fonctionnait aussi. Plusieurs jours après la distribution du pain, un Français venait m'en apporté un morceau supplémentaire.
 Est-ce mes cibles rouges sur le costume ou mon jeune âge qui m'ont valu ce soutien ? Seul André Louvel, de Deauville, pourrait le dire, c'est lui qui est désigné pour cette distribution. C'est un des rares, qui est des nôtres aujourd'hui, à avoir tenu le coup dans cet enfer jusqu'à la Libération. Aujourd'hui encore, j'ai une grande pensée pour lui.
Est-ce mes cibles rouges sur le costume ou mon jeune âge qui m'ont valu ce soutien ? Seul André Louvel, de Deauville, pourrait le dire, c'est lui qui est désigné pour cette distribution. C'est un des rares, qui est des nôtres aujourd'hui, à avoir tenu le coup dans cet enfer jusqu'à la Libération. Aujourd'hui encore, j'ai une grande pensée pour lui.
Même avec un feu de bois sur la butte de sable, nous n'arrivions pas toujours à sécher notre veste et nous rentrions dans nos blocs. Le matin, on subissait l'appel avec des vêtements humides et il fallait reprendre la navette et le travail dans cet état. Les nuits étaient coupées par des contrôles de poux (läusekontrolle). Aux distributions de soupe, on nous alignait à coup de louches. Le partage du pain le soir (le couper en quatre sans couteau) tournait en bagarre. Malheur si une alarme survenait lors de la distribution, la lumière s'éteignait et c'était la ruée sur celui qui tenait la boule.
Les Russes étaient les maîtres dans le trafic de nourriture ou les échanges divers, ils risquaient beaucoup. Cela leur valait des bonnes trempes de la part des kapos et ils reprenaient souvent le travail la tête bien amochée et parfois même on ne les revoyait plus du tout, remplacés aussitôt par d'autres. La main-d'œuvre ne manquait pas ! De toute l'Europe arrivaient les hommes raflés par la police du grand Reich qui se rétrécissait tous les jours. Ils remplissaient les vides dans les camps de concentration, ceux qui partaient en fumée. La nourriture se faisait rare, la soupe plus claire et le pain ressemblait de plus en plus à de la sciure de bois. Le travail lui était le même.
Nos mains gercées et écorchées se brûlaient au contact de l'acier gelé des wagonnets qu'il fallait pousser. On avait du mal à tenir la pelle. Des trente et un déportés du commando de mai 45, il n'en restait que quatre en novembre, dont moi. Seul un éboulement dans les Stol où un incident au convoi nous donnait quelques répits autour du feu. Là, en essayant de nous sécher, on rongeait un morceau de charbon de bois, cela calmait la faim et surtout nos diarrhées fréquentes. Nous en apportions aux copains malades. Ceux qui venaient remplacer les éclopés arrivaient souvent avec des costumes neufs, nous qui avions les mêmes haillons depuis des mois, c'était souvent une source de trafics dont, malheureusement, ils subissaient les conséquences.
Nous dépérissions sans nous en apercevoir. J'avais des furoncles au cou et sous les bras, les chevilles enflées, mais le moral quand même. La guerre ne devait-elle pas finir bientôt ! Les papiers de ciment sous la veste, le feu, la solidarité n'y ont rien fait. Christian Brignot et Jacob Toussant (mon copain de lit) sont partis les premiers comme malades du "Revier". Dans les blocs, devant l'afflux de déportés, on nous a mis à trois par lit. Les nuits étaient infernales, avec la barrière des langues, les disputes ou bagarres étaient monnaie courante. C'est ce qui est arrivé une nuit où je tentais de dormir avec deux inconnus sur ma paillasse. Le kapo arrive pour nous faire taire et, en prenant une planche de lit, tape sur nous trois ; mais en voyant les cibles rouges sur mon costume, c'est le "cochon de Français" (schweine Franzose) qui prend tout. Mes furoncles saignent et je n'ai que la queue de ma chemise pour m'essuyer. Quelle nuit!
Le matin, mon matraqueur polonais vient me dire qu'après l'appel, je dois revenir au bloc. C'est l'angoisse ! Pour quoi faire ? A-t-il eu, ce sauvage, une lueur d'humanité ? Je me retrouve avec une quinzaine d'autres malades ou éclopés dans un convoi qui part au camp central à quelques kilomètres de là. Aussitôt, la grande porte franchie, nous descendons le petit escalier tout à côté pour prendre une douche qui, cette fois, est bonne et calme mon angoisse. Après avoir enfilé une chemise et un caleçon propre (depuis sept mois j'ai les mêmes) c'est au "Revier" que l'on nous emmène. C'était le 26 novembre 1944, au "Russen Lager" où j'ai rencontré J. Coquelet, cheminot de Rennes.
Le bloc dégage une drôle d'odeur mais allongés comme on peut, sans travailler, on ne sent pas les morsures du froid. C'est déjà bien. Le lendemain, on incise mes furoncles (j'entend le mot carbonculose) ils me les recouvrent d'un pansement en papier. Les quinze jours passés au "Revier" furent atroces vu l'ambiance de mort qui y régnait. Nous avons subi une désinfection, où, tout le monde dehors, sans vêtement, attendions la fin du gazage du bloc et de nos chemises. Nus dans le froid en faisant la "pelote" combien y sont restés s'évanouissant doucement sur le verglas... Mes plaies à peine cicatrisées, un matin on appelle mon numéro pour retourner en quarantaine. Il fallait des "spécialistes".
 Mödling, fabrique souterraine d'avions à réaction: (Témoignage)
Mödling, fabrique souterraine d'avions à réaction: (Témoignage)
Je suis désigné pour partir à deux cents kilomètres de Mauthausen, à Mödling, dans une fabrique souterraine qui construisait le prototype du Heinkel HE 162, d'un des premiers avions à réaction au monde.
Adieu mes Russes et leur kapo Michka à visage humain. Il m'avait, sans le savoir, sauvé la vie en m'intégrant brutalement dans son groupe, m'évitant ainsi de retourner dans le tunnel au commando "Bora". Un bon kapo pourtant ses amis soviétiques, très nationalistes, lui promettaient de lui faire un mauvais sort, la guerre terminée. Que sont-ils devenus ? J'ai souvent sur ma paillasse du "Revier" pensé aux sept mois passés ensemble.
C'est le 22 décembre l944 que, tous habillés de neuf, nous quittons la forteresse à pied pour prendre un train de voyageurs en gare de Mauthausen. Nous sommes vingt, bien encadrés qui encadrés, qui montons tout étonnés avec des voyageurs ordinaires. Ils nous regardent plutôt tristement. Par les vitres, on voit la campagne enneigée, les fermes et les habitants ; nous ne sommes plus en camp de concentration et roulons vers l'inconnu. Cela dure la journée entière, avec beaucoup d'arrêts. Le soir un camion découvert nous fait traverser Vienne, la capitale disent certains, et en pleine nuit nous arrivons dans un petit camp tout illuminé par des projecteurs : c'est Mödling niché dans la montagne. Je ne le voyais pas mais j'étais dans un piteux état.
Dès le lendemain, des Français sont venus me voir. La solidarité était bien organisée dans ce camp et j'en ai bénéficié une fois encore. Je ne résiste pas à l'envie de citer des noms d'hommes qui risquaient gros pour en soulager d'autres : et je pense à Henri Le Maout un Parisien, à Jo Attia* un gars né dans mon pays, à La Richardais à côté de Saint-Malo, qui m'apporta la première gamelle de soupe de la solidarité, à Gilbert Cosson un ancien de 14-18 élu à Saint-Didier (assassiné lors de l'exode) et à Marcel Platz. C'est grâce à eux que je m'en suis sorti. Je peux parler aussi de l'amitié de deux jeunes, Auguste Chene, un marseillais, et Georges Charlier, nous formions un trio inséparable qui a duré jusqu'au 5 mai à la libération de Mauthausen. Georges, le Niçois, hélas ! est mort aussitôt après avoir embrassé sa maman en arrivant en France. Il avait 23 ans.
Mais la nouvelle vie à Mödling c'est une autre histoire qui commence bien mais qui finira par une sanglante marche forcée de deux cents kilomètres pour rejoindre Mauthausen, du 1er au 7 avril 1945. Deux cents d'entre nous seront enterrés sommairement sur les routes de l'exode et tous les malades du "revier" assassinés avant de partir. Ils étaient 50.
Combien de fois ai-je entendu dire, surtout par les plus anciens : « Ceux qui en sortiront il faudra qu'ils racontent.» Je leur dédie mon modeste témoignage par ces quelques pages. Pour que nos enfants sachent ce qu'a été le nazisme et où peut mener la folie des hommes. Il est vrai que cela continue aujourd'hui.
Les "JUD"
Cependant, mon devoir de mémoire est pourtant bien incomplet. Je n'ai pas parlé des juifs contraints toute la journée à vider la fosse d'aisance avec des gamelles et des seaux. Ils étaient dedans tous nus, les déjections leur arrivaient jusqu'à la ceinture. Des enfants y travaillaient aussi. En faisant la chaîne ils vidaient leurs seaux dans des citernes à deux roues. C'est le plus horrible spectacle que j'ai pu voir. Peut-on avilir davantage un être humain ?
Ces juifs vivaient dans quelques blocs à part et étaient la cible particulière des Kapos et hélas de certains détenus ordinaires. Un très grand violoniste hongrois est venu un jour jouer au bloc n° 1, le lendemain ils l'ont tué. Pourquoi ? parce que c'était un "Jud". Les "Jud" viennent nous parler souvent dans notre langue ce sont des intellectuels pour la plupart et il n'y a que les Français pour les accepter. Leur état plus pitoyable que le nôtre, plaies purulentes, des marques de coups partout, ils seront tous exterminés. Parmi eux de nombreux jeunes enfants. Le plus incroyable était leur résignation et leur espoir d'en sortir bientôt.
Il faudrait écrire encore de longues pages pour décrire les interminables appels qui se prolongeaient loin dans la nuit quand il manquait un ou deux hommes. Il fallait, debout dans le froid, la pluie et le vent, attendre que le compte de bagnards y soit, morts ou vifs. Souvent c'était un détenu que les kapos retrouvaient épuisé dans un coin, pour lui c'était la fin. Il arrivait parfois que tout le camp reparte au travail le matin en étant resté debout toute la nuit dehors.
Quelques-uns d'entre nous tentaient de s'échapper et quand ils étaient repris les kapos les attachaient à la portée du camp les laissant mourir ainsi. A la sortie des commandos, l'ordre : "tête droite" était donné pour les regarder avec leur pancarte : "nous voici revenus". Dans quel état les pauvres ! Il s'agissait toujours de Soviétiques.
Il faudrait aussi raconter les réveils en plein sommeil pour faire un "lauskontrol" où les kapos homosexuels se délectaient sur nos parties intimes. Décrire les séances quotidiennes des "25 coups sur le cul" de ceux qui avaient "fauté" (parfois 30 ou 40 coups de "schalgue"). Parler encore des orgies que nos tortionnaires faisaient certains soirs avec leurs mignons dans leur chambrée au bout de notre bloc. Ils se goinfraient et buvaient au son de l'accordéon.
Je n'oublie pas non plus les nombreux suicidés ; les "waschraum" (lavabos, qui servaient de morgue avec tous les morts entassés que l'on enjambait pour avoir un peu d'eau, quand il y en avait), ainsi que les chariots tirés par nous, pour emmener tous les matins les morts au crématoire du camp voisin Gusen I.
Il n'est pas étonnant que 50 ans après, les nuits de ceux qui en sont revenus en soient encore perturbées.
Pourtant les SS et kapos, ces sous-hommes, n'ont pas réussi dans leur entreprise d'avilissement. Bien au contraire, malgré nos conditions de vie atroces, nous avons pu organiser clandestinement une solidarité qui a sauvé la vie à beaucoup d'entre nous. La Résistance a continué avec une certaine forme de sabotage dans le travail forcé dans les camps.
La solidarité a beaucoup compté. Des "tapes" amicales sur l'épaule, des sourires, des poignées de main de la part d'inconnus ne parlant pas la même langue, ça comptait pour le moral. Nous étions tous victimes du nazisme allemand.
Certains osent mettre en doute ce que nous avons vu et vécu durant ces années noires.
Effacer ce génocide, le nier, nous ne le tolérerons pas tant que nous serons de ce monde.
Il faut que notre triste expérience serve de leçon à notre jeunesse.
Nous ne sommes pas aujourd'hui à l'abri d'une telle dérive où est tombé le peuple allemand, pourtant un grand peuple comme le nôtre.
Si le monde d'aujourd'hui n'est pas le monde dont nous rêvions sur la place d'appel du Camp de Mauthausen, une fois libres, c'est la démonstration que la liberté, la démocratie et le respect des autres restent toujours à conquérir et à préserver.
Puisse mon modeste témoignage, contribuer à lutter contre l'oubli qui serait la pire des choses."
Jean COURCIER
Ajouter un commentaire
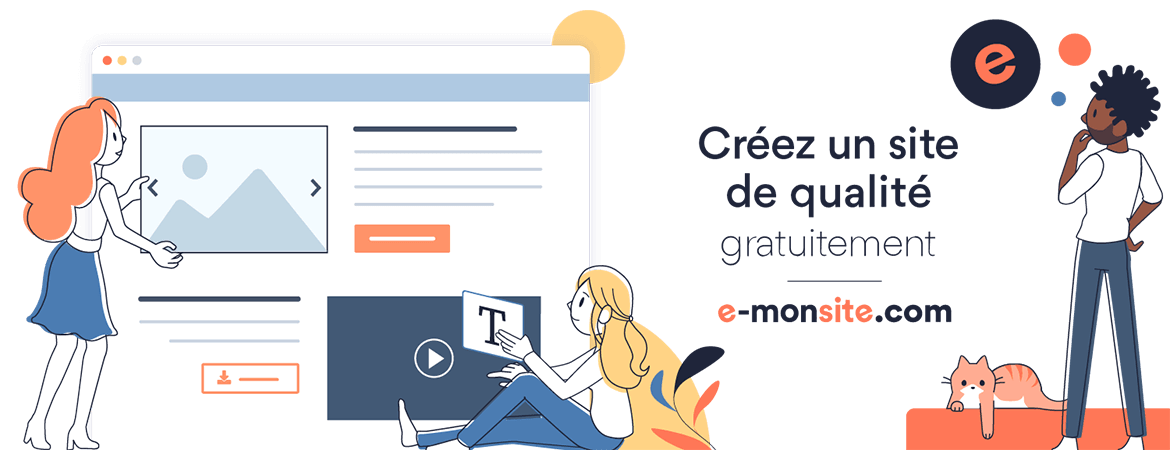

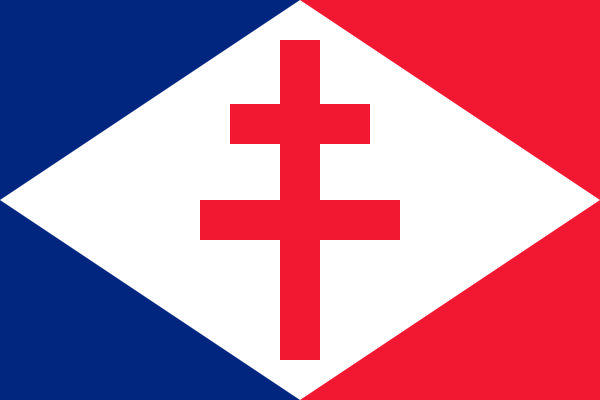



















 Français
Français
 English
English
 Español
Español
 Italiano
Italiano
 Deutsch
Deutsch
 Nederlands
Nederlands
 Portuguesa
Portuguesa




